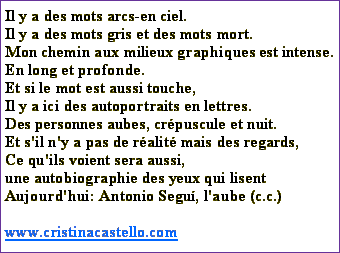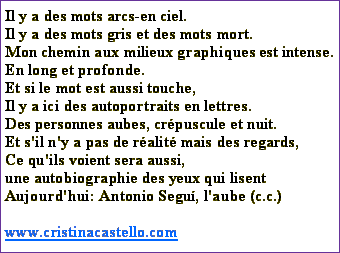|
- París
Entretien avec Antonio Seguí, peintre, sculpteur et graveur argentin
«Tandis qu'il existe des hommes qui aient les mêmes besoins que les miens, la peinture existera.»
Son œuvre, d'où nous regardent les nains autoritaires d'opérette, dans un monde où l'humour n'est que la courtoisie de l'horreur
Par Cristina Castello
Antonio Seguí (Córdoba, Argentine, 1934) habite à Paris depuis 1963 et il est l'un des artistes plastiques plus internationaux de son pays. En 1958, il a voyagé au Mexique - où il a connu David Alfaro Siqueiros -, avec l'espoir de trouver une peinture qui lui permît de pénétrer l'essence d'Amérique Latine. Il s'est déçu. Il a vu dans les partisans de ceux qui se dédiaient à la peinture murale une image «rebattue, académique et presque commerciale». En 1963, il a exposé à la Biennale de Peinture Jeune de Paris, et dès lors des prix et des honneurs se suivent.
Parmi eux, il a représenté l'Argentine à la Biennale de Venise; il a gagné le Premier Prix au Musée de Lodz (1967), la Médaille d'honneur à la VIIIe. Biennale de Gravure de Cracovie (1986) et le Grand Prix Fondo Nacional de las Artes (Buenos Aires, 1990).
Même s'il habitait à Paris, pas mal de fois l'a menacé de mort la dictature militaire qui a pris le pouvoir en Argentine dans la période 1976-1983; et en 1982, une rafale de mitraillette l'a ouvert la tête, à la maison. C'était le style de ces militaires, avec qui ne renoncent pas à la liberté, à la paix, ni à la démocratie et commettent le «péché» de l'intelligence.
Seguí a de l'humour, de l'ironie et de la subtilité. Comme son œuvre, d'où nous regardent les nains autoritaires d'opérette, dans un monde où l'humour n'est que la courtoisie de l'horreur. Et où pour lui, les souvenirs sont de l'expérience. Comme le tango et comme Carlos Gardel.
Par Cristina Castello
- Qui est Carlos Gardel?
- C'est la couverture d'El alma que canta sur le lit de jeunes filles de ménage chez mes parents. Sourire énorme et tragacanthe en gros, avec deux gouttes d'eau de Cologne de La Franco Inglesa. Quelquefois, on l'a vu aux environs de Tacuarembó avec le visage couvert par les bandages, chapeau noir et un sourire qui ne pouvait être que le sien. D'autres, à 80 kilomètres de Medellín, avec la face gâtée, la denture intacte et accompagné d'un guitariste blond qui semblait un ange. Gardel a été le témoin de mes premiers sursauts amoureux. De mes premiers matés avec un zeste d'orange que j'ai pris, avec la même sensation que quelques années plus tard j'ai ressenti tout en fumant ma première cigarette de marijuana.
- Son œuvre se nourrit des images des temps d'enfance. Je parle des jouets en bois de l'époque de la Seconde Guerre Mondiale, des gauchos des calendriers, du San Martín du magazine «Billiken»…
- Oui, je crois que la plupart de mon travail est le produit de la mémoire de mon enfance, c'est là que se trouvent la racine de mon sens ludique et celle de l'humour, à Córdoba. Je me suis inspiré de la revue Leoplan pour la série de Felicitas Naón avec laquelle j'ai participé à la Biennale des Jeunes de Paris, qui a été un peu le moteur qui m'a laissé ancré dans cette ville. Plus tard, j'ai fait la série A usted, de hacer la historia y los objetos en trois dimensions issues directement de Billiken.
- Comme des miroirs de parcs d'attractions, les souvenirs le révèlent et expliquent votre œuvre?
- Oui, il y a une partie de «mes archives» qui m'aident à reconstruire l'histoire de mon enfance. Je pense, par exemple, que le mur que j'ai peint à Boulogne-sur-Mer a aussi son origine dans mon enfance, et que mon souvenir d'un puzzle des thèmes marins m'a mené à faire ce mur céramique de Lisbonne. Et puis, les petites maisons par-ci et par-là de la série Los Barrios ont été comme celles que je peignais très petit, quand j'accompagnais Ernesto Farina dans la Córdoba ravin. Dès que nous installions nos chevalets, de petits enfants qui sortaient des maisons et des adultes s'approchaient de nous et nous demandaient:«Tu peins?», «Non, je prends des gouttes» (¿Tai pintando?», «No, estoy tomando gotas»), leur répondait Ernesto… et peu de temps après ils se marchaient, assez déçus. Il me semble les voir encore!
- Dans son œuvre, l'humour donne l'impression d'être un clin d'œil de l'intelligence.
- Les définitions ne me plaisent pas… vous le savez déjà.
- Vous me parliez de l'aliment nourricier pour votre œuvre…
- Disons que les bandes dessinées ont été mon aliment, les caricatures politiques de mon enfance, les almanachs d'Alpargatas qu'emportait mon père et tant d'autres choses d'alors qui viennent maintenant à ma tête! C'est qu'en Argentine, nous n'avons jamais été avares comme fabricants des sourires, et cela est quelque chose à revendiquer, parce que nous ne devons pas nous éloigner de nos vertus. Comment oublier? D'ailleurs, combien de fois Molina Campos m'a fait rêver?
- Dans un sens contraire, je me souviens de ces hommes de 1977 dans vos peintures, seuls et presque toujours face à un mur, comme dans «La distancia de la mirada».Ils sont une prophétie du vingt et unième siècle?
- Non…, mais quelquefois les circonstances relèguent les jeux, et l'humour assombrit. Alors, il apparaît des séries comme celle que vous mentionnez et que j'ai fait dans la période 1976-1977, ou comme les Paisajes de la pampa, que j'ai commencé après la mort de mon père. À ce moment-là, je n'aurais pas pu faire autre chose.
- Exactement, aujourd'hui le monde est si désolé comme vos «Paisajes de la pampa». et dans vos œuvres, les pavés et les petits hommes à long nez, seuls et inquiétants, questionnent l'univers. Quelle est la racine de votre vision plastique?
- L'humour et certain regard ironique de la société à laquelle j'appartiens, et de laquelle je me ressens en quelque sorte, exclus, sont le cordon ombilical de mes choses. Mais, ceci n'est pas récent: je le traîne dès mes premiers pas par les écoles de Beaux Arts de Córdoba. Et dès la fin des années 50, j'ai travaille par séries, qui ont un nombre indéterminé d'œuvres, et pour chacune d'elles j'adapte la technique employée. C'est ainsi que sauter d'une à l'autre, ou laisser des espaces pour mon travail graphique, pour le dessin ou pour la sculpture, me fait du bien. De cette manière, j'évite la fatigue et je garde une fraîcheur qu'on ne se sait pas si je la réussirais d'un autre mode.
- D'une certaine manière, vous vous sentez exclus, vous me dîtes, et je pense que ceci est probable à cause de nombreuses «installations» et «performances» que nous voyons aujourd'hui et on parle d'«art numérique» et tout cela semble loin de vous.
- Dès le début des années 60 les installations font partie de l'abécédaire du monde de la plastique. Il y a des choses qui demeurent et beaucoup d'autres qui ont disparu. Mais, on doit reconnaître que les nouveaux outils de travail qui s'offrent aux nouvelles générations, et qui évoluent jour après jour, éveillent la curiosité de n'importe qui.
- Les installations sont de la peinture, ou il faut écouter ceux qui préconisent, de nouveau, la mort de l'art?
- Je pense que, dans la intégration avec l'architecture et la construction de grands spectacles, les installations jouent un rôle prépondérant. Mais, la peinture est une autre chose. La peinture possède action physique et le plaisir de faire. La complicité des mains et avec ce qui il y a dans la tête. Le besoin de laisser une trace sur un support ou d'écraser avec les doigts un morceau de cire, qui peut se transformer en sculpture. C'est pour cela, quoiqu'on parle de la mort de la peinture… Non! Tandis qu'il existe des hommes qui aient les mêmes besoins que les miens, la peinture existera.
- Qu'est-ce qui différencie les installations des années 60 de celles du vingt et unième siècle?
- Je dirais que les expositions de ce type dans lesquelles j'ai participé à cette époque-là avaient un but. Nous voulions faire enrager les vieux et nous amuser de notre côté. L'humour était le dénominateur commun de ces expositions et le rire est toujours bienfaisant, vous le savez déjà. Mais, avec le temps, la sémantique se modifie et ce qui dans notre époque suffisait pour faire enrager les vieux, aujourd'hui constitue les drapeaux de l'art officiel. Çà et là.
- Vous n'avez pas de drapeaux, vous ne répondez ni aux modes ni aux «ismes», malgré tous ceux qu'on vous a attribué. Il y a des années, et d'après les amants des enseignes, vous avez été américaniste, non formaliste, surréaliste, néofiguratif, pop, expressionniste et tant et plus «ou moins», puisque les enseignes corsètent. Il se peut que la fidélité à vos propres voix soit votre seul «isme»?
- Comme vous le suggérez, nous faisons des choses et d'autres se préoccupent de nous classer. Et bien sûr, tout ce qui nous émeut, influence notre travail et personne n'est un produit de génération spontanée. Mais, je n'ai jamais cru aux classements dogmatiques, et il me semble horrible que le spectateur m'identifie par certains tics ou façons d'agir. Non. Je ne suis ni conscient d'"appartenir" ni ceci a été mon intention.
- Fréquemment, le talent et la liberté paient des prix. Par exemple, quand Emilio Pettorutti s'est fâché parce que votre œuvre, nouveau venu à Paris et très jeune, a été reconnue. Et il s'était déjà passé quelque chose de pareil au Mexique avec David Alfaro Siqueiros, quoique cette relation ait changé après, en Europe…
- C'est comme ça, mais ce sont seulement des souvenirs que je garde comme anecdotes et pas plus. Je n'ai jamais connu Pettorutti et avec Siqueiros, j'ai pu comprendre, parfaitement, qu'il détestât ce que je faisais alors au Mexique. De toute façon, il s'est réconcilié quand il a vu mes desseins expressionnistes, que j'ai continué en marge d'autres grands tableaux abstraits avec coupures et déchirures. Mais oui, je crois que j'ai payé des prix.
- Comment cela?
- Je veux dire que le plus cher, et cette fois dans un sens absolument littéral, il a été en 1970 au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. J'avais été invité à présenter une sélection de tout mon travail graphique, de l'année 63 à l'année 70. À ce moment-là, mon vieil ami, Ed Shaw se trouvait ici, et il m'a aidé avec l'accrochage des œuvres. Le jour du vernissage, nous avons mangé quelque chose dans un restaurant des alentours et avant d'aller nous mettre élégants, nous avons décidé de jeter un dernier coup d'œil sur l'exposition…
- Elégants et simples…il s'agit d'un style. Que s'est-il passé avec ce dernier coup d'oeil?
- Cinquante mètres avant l'entrée une terrible explosion nous a surpris. Des nuages lourdes et jaunâtres sortaient des portes du musée. Beaucoup de gens couraient, d'autres échappaient épouvantés par les portes de sécurité, et nous ne comprenions rien. Il y a eu quelques minutes d'attente et après, parmi des gens qui se secouaient de la poussière, nous avons su que tout le faux plafond de ma salle s'était détaché. Plus de cent objets avec leurs correspondants cadres en aluminium, passe-partout de soie crème et plexiglas, demeuraient en mille morceaux mélangés avec panneaux de plâtre et câbles du système électrique. Ni le musée n'avait d'assurances pour ces expositions temporelles, ni je n'avais pris la précaution de les engager.
- D'ailleurs, vous avez payé d'autres prix dans le sens où nous parlions avant, mais sans avoir fait des concessions, vous avez une place dans le milieu de la grande peinture. Et, soit dit en passant, je n'oublie pas comment votre nom a fait presque le tour du monde, même par votre œuvre «Suggérant la catastrophe».
- Mais, comme vous vous imaginerez, celle-là a été une anecdote bizarre! Dans l'année 1998, j'avais fait une exposition à la Maison de l'Amérique Latine et à la Galerie Marwan Hoss. J'ai exposé de l'art précolombien et trois tableaux En attendant l'avion noir, Quand l'avion noir part et Quand l'avion noir a passé. Les deux premiers se sont vendus et le dernier - qui ne possédait pas de titre derrière - est resté et je l'ai gardé dans un petit coin. Après, quand la FIAC 2001 s'est réalisée, j'ai voulu montrer le tableau mais, bien sûr, il fallait lui mettre un nouveau titre et on l'a appelé Suggérant la catastrophe. C'est le tableau qui a accompagné l'invitation allongée pour cette exposition… Regardez… Vous voyez? C'est celui-ci. Mais regardez la date… il dit du 10 au 15 octobre 2001, à la Galerie Claude Bernard. Entre-temps, il est arrivé le 11 septembre, et jusqu'aujourd'hui les gens continuent à croire que je l'ai peigné après… et délibérément.
- C'est pour cela que l'on peut parler peut-être de l'anticipation de l'art?
- Bon, je ne dirais pas autant, simplement cela me semble curieux.
- Je pense maintenant à «La leçon d'anatomie du docteur Tulp», de Rembrandt, une sorte de portrait de l'«establishment» de médecins néerlandais du XVIIe siècle qui a inspiré chez vous pas mal d'œuvres satiriques. En ces jours, à mon passage pour les galeries de Paris et d'autres villes d'Europe, j'ai vu peu d'expressions authentiques de peinture, en réalité, plus de mode que de peinture, tandis que pour bien de bons artistes il n'est pas facile d'exposer. Il existe un «establishment» dans l'art qui ouvre ou ferme des chemins?
- De bons peintres avec difficultés pour entrer au marché de l'art, il y en a eu toujours. Et quelquefois, je ne l'ai pas compris. Mais, peut-être l'establishement joue, aujourd'hui plus que jamais, un rôle prépondérant pour la carrière de quelques artistes. D'autre part, nous savons déjà que Paris a aujourd'hui le même schéma que les autres grandes villes de l'art, comme New York ou Londres. Ici, l'art contemporain, par exemple, se trouve aux alentours de la Bibliothèque François Mitterrand, la région du Marais est dédiée aux gens plus ou moins de ma génération, tel que, avec quelques exposants isolés, le XVIe arrondissement ou Saint-Germain. Entre les uns et les autres, des horreurs comme partout.
- Et en Argentine, comment répéter cette fécondité des fins des années cinquante et presque tous les soixante, avec l'appui pour l'art d'un Jorge Romero Brest, un Aldo Pellegrini ou un Hugo Parpagnolli, et avec tant de bons artistes de ce temps-là?
- C'est que la culture - qui se développe immédiatement quand la société vit des périodes pleines - n'a jamais été prioritaire en Argentine. Alors, il apparaît toujours des organismes et des fondations qui remplacent le rôle de l'État. À mon époque, la Fundación Di Tella a joué ce rôle, non seulement dans les arts plastiques mais encore dans le théâtre et dans la musique. Comme vous vous rappellerez, son interruption s'est produite immédiatement après le coup d'état contre le docteur Illia, et ceux qui ont tellement réclamé alors l'intervention militaire, ils l'ont tellement regretté après.
- Je pensais à Córdoba et à une génération d'artistes qui semble unique. La vôtre, qui est aussi celle d'Eduardo Bendersky, Marcelo Bonevardi, Ernesto Farina, José "Bepi" De Monte, Pedro Pont'Verges, Diego Cuquejo.... Et sans doute, il y a des artistes importants des générations postérieures, et aussi parmi les jeunes et les adolescents. Et encore, il semble qu'après vous, l'histoire se serait arrêtée…
- C'est vrai que cette génération avait fait des expositions à Córdoba et à Buenos Aires, et en 1955, quand je suis venu d'Europe, ses artistes constituaient le groupe le plus actif. Mais, il n'en est pas moins vrai que pendant dix ans la culture argentine a vécu en secret. Et à partir de l'arrivée de la démocratie, une quantité de jeunes artistes, peintres, sculpteurs et d'autres, ont rempli ce vide. Córdoba compte aujourd'hui sur la première galerie dont l'architecture a été prévue pour cette fin. Les musées sont sans moyens économiques - comme d'habitude -, mais on fait des choses: ils sont actifs. Et les écoles d'art sont envahies d'élèves, ce qui ne se passait pas à mon époque.
- Vous avez fait vos premières expositions à Córdoba et à Buenos Aires, en 1957 et 1961, respectivement, mais, bien sûr, après avoir été reconnu en Europe. Et de cette manière agit Argentine avec ses artistes et scientifiques: elle ne leur donne rien quand ils sont en train de surgir et après elle s'attribue le mérite de leurs triomphes, si luttés. C'est un pays expulsif?
- Bon, j'accepte que tous applaudissent le sportif qui réussit hors le pays, tandis que le scientifique et l'artiste sont suspects. Mais, l'Argentine est comme elle est. Et quand une lumière d'espoir allume un peu le chemin, nous devenons tous, heureux. Comme à présent, sans savoir trop pour quoi. Mais nous sommes un peu comme ça, et c'est ainsi que nous devons nous assumer
- Depuis 1962 vous habitez à Paris, mais vous conservez des habitudes «criollas» comme le maté et l'«asado» et Córdoba n'est pas un souvenir chez vous, mais expérience.
- Je vais vous dire, comme si je serais un psychanalysé, que j'ai déjà résolu le problème de Dieu et que j'ai résolu le problème de la mère. Mais celui de Córdoba, il me reste en suspens.
- C'est votre pays celui de "porque me muero si me quedo / pero me muero si me voy"*, comme le dit la chanson de María Elena Walsh?
- Voyez, je suis parti tout jeune et beaucoup de fois j'ai pensé à y retourner et laisser mes os à Villa Allende (Córdoba), mais je l'ajournait. Peut-être, parce qu'être ici ou là, bon… mon rythme est semblable, mon atelier de Paris est ce qu'on appelle là un «quincho», l'asado que j'obtiens ici est quelquefois meilleur que celui de là-bas, avant, ici il était une complication trouver de l'herbe et quelquefois j'ai dû l'acheter à la pharmacie, mais maintenant il y en a partout, et du vin, qui, sans doute en Argentine, a beaucoup amélioré, je ne parle pas!
- Vous avez créé le Centre d'Art Contemporain (Centro de Arte Contemporáneo) au Château Carreras, de Córdoba, qu'est-ce qui vous pousse à ouvrir les mains en temps de poings fermés et d'individualisme?
- Vous savez déjà que lorsque j'étais ici, et au milieu de la tradition judéo-chrétienne, je me suis senti toujours en faute. Et une manière d'expiation a été avoir voulu inventer cet autre centre d'art, mais mon intention était bien une autre, par rapport à la manière de transformer ce lieu. Voyiez… je crois qu'il a été la seule fois que j'ai perdu avec résignation et rage en même temps, parce que je suis convaincu que mon idée était bonne.
- Vous êtes un donnant: vous avez donné aussi trois cent trente et une de vos œuvres au Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en 2001.
- Oui, parce que la directrice, qui est une vielle amie, me l'a suggéré, et disons que je suis naturellement l'opposé d'un avare.
- Il est possible que dans un certain sens et d'une manière propice, vous n'avez pas grandi et vous gardez l'enfant… celui qui voyiez le soleil se cachant, en même temps que le paysage de Córdoba se couvrait de sauterelles, comme vous l'avez dit quelquefois?
- Oui, j'ai grandi, je ne sais pas…, mais c'est sûr que la mémoire d'un enfant demeure intacte. Je ressens jusqu'à l'odeur de la cire des planchers de ces couloirs qui nous emportaient au rayon «enfants» de Gath & Cháves. Cette odeur d'eucalyptus des ascenseurs de la maison Tow, le goût du jambon York au restaurant de l'Hotel Bristol, où nous allions souvent avec ma grand-mère… où il fallait manger très lentement et laisser un petit peu pour que le garçon ne porte pas l'assiette vide. Et les dimanches..! Ah...! Les dimanches étaient les croissants avec du chocolat épais de La Oriental et passer par la boulangerie Europa pour recueillir les meringues de crème chantilly..!
- Bien sûr, dans la rue 9 de Julio, de Córdoba… c'était un rite.
- Oui! Et plus tard nous allions directement au stade de Belgrano, où quelquefois nous perdions et parfois nous gagnions. Et après, Perón, que pour de différentes raisons je n'ai jamais pu comprendre, est arrivé; et mes voyages sont arrivés, et l'aventure. Et j'ai découvert que ma vie s'était passée sans sursauts. Et que pour les autres, pour la plupart, le truc était plus difficile, et que je ne pouvais pas faire tout ce que je voulais à Córdoba. Et alors… alors je suis venu sans venir et je reste sans rester.
- Antonio, où est et qu'est-ce que la «patrie»? C'est la Córdoba de votre naissance, avec ce caléidoscope d'images qui le révèlent et lui expliquent? Il s'agit peut-être, de vos maîtres: José Gutiérrez Solana ou les allemands Otto Dix et George Grosz...?
- La patrie, la patrie… Qu'est-ce que c'est? Où est-elle? Là où l'on est né, où les racines sont bien établies, où l'enfance s'est écoulée sans trop de problèmes? c'est le lieu où j'ai pu faire et vivre de ma passion, la peinture..?
- ...C'est-à-dire que «patrie» peut être ce Paris de ses derniers quarante ans et de votre consécration comme artiste?
- Voyez… Je n'ai jamais eu de problèmes de déracinement, mais je le dirais qu'étant ici je regrette Córdoba, et à Córdoba je regrette Paris. C'est comme être assis sur deux chaises, mais pour passer de l'une à l'autre il faut un vol d'Air France qui dure treize heures.
- En 1983, vous m'avez dit qu'un jour vous habiteriez à Ibiza ou à Cartagena, ou à New York, ou au Puerto Rico, ou en Jamaica ou à Colonia (Uruguay). Maintenant, il semble que ce jour arrive: quel lieu vous logera finalement?
- Quand vous me l'avez demandé alors, certainement, je n'avais aucune réponse assez mûre, et à présent, j'exclurais les villes que je vous ai nommées à ce moment-là. Pour fermer le cercle, je me pencherais vers Córdoba. Mais, ne me pressez pas, je vais le décider quand je serai grand.
*«Parce que je meurs si je reste / mais je meurs si je pars»
© Cristina Castello, 2004 - Tous droits réservés pour tous pays. Traduction: Raquel Chazki
- Publié dans «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid)
|
|